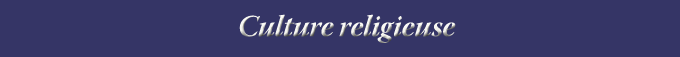Alors que dans la Grèce antique le bonheur est le résultat d’une certaine sagesse individuelle, dans les religions révélées le bonheur n’est possible que dans l’amour de Dieu. Dès lors, l’éthique consiste à chercher dans la parole de Dieu les réponses aux questions éthiques que l’homme se pose. Quand la réponse ne se trouve pas explicitement dans les livres sacrés, les croyants s'adressent aux clercs de la religion pour leur demander conseil. Les décisions s'imposent donc de l’extérieur; elles ne sont plus le résultat d’une réflexion éthique qui se nourrit du dialogue et de l'échange d’idées. Ces deux conceptions s’affrontent.
C’est avec Saint-Thomas d’Aquin (né vers 1225) que l’autorité de l’Église renoue avec la pensée des philosophes grecs. Ce Chrétien est parvenu à une réconciliation en montrant la complémentarité entre les vérités de la raison et celles de la foi. Les quatre vertus cardinales des Grecs de l’Antiquité (courage, justice, prudence, tempérance) viennent ainsi compléter les trois vertus chrétiennes : la charité, l’espérance et la foi.